|
FONTEVRAUD
28 Mai 2005
|
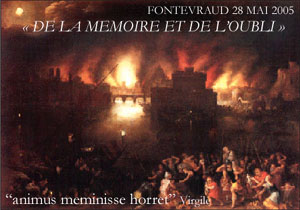
Troie
en flammes,
Brueghel Jean, dit l’Ancien, vers 1595
…Animus meminisse horret…
(Virgile,
Enéide, livre II, v.12)
|
MEMOIRE – OUBLI – JOURNAL
INTIME
Professeur
G. BESANçON |
Avertissement :
toute référence à cet article doit faire mention de son
auteur et du site de la "Psychiatrie Angevine"
Copyright 2005 |
Un contremaître qui s’appelait
Lederlecha et qui portait « une moustache de tigre » avait
recueilli, par tradition orale, certains détails que je vais rapporter
sans trop y croire (étant donné que l’oubli et la mémoire sont également
inventifs – José Luis Borges – Le rapport de Brodie).
Cette
remarque de Borges s’articule parfaitement à notre sujet et vérifie
cette réflexion de Platon (Le mythe de la caverne) bien avant Freud que
croire à la réalité d’une perception est illusion et qu’il
s’agit en fait d’un reflet forcément intime.
Ceci
est vrai pour le journal intime. Il n’y a pratiquement aucun écrit
intime qui reflète exactement le vécu de son auteur.
Julien
Green écrit le 5 février 1939 « je crois qu’une des plus
vaines préoccupations de l’écrivain qui écrit son journal est celle
d’une cohérence absolue ».
Le
même Julien Green écrivait le 3 juin 1936 « si l’on découvrait
ce journal, il donnerait de moi une idée fort inexacte, car je n’y
mets guère que ma vie extérieure ; ce qui se passe en moi et qui
est contradiction absolue avec ma vie extérieure, je ne puis en parler
ou j’en parle très mal ».
Ou
encore le 24 juin 1937 « je finirai par me déprendre tout
à fait de ce journal parce que je n’ai pas réussi à y mettre ce qui
compte réellement pour moi ; bien peu de mes difficultés intérieures
transparaissent dans ces pages ».
Ces
quelques citations avaient pour ambition d’introduire, par quelques
exemples, le propos global.
La
mémoire et le journal intime. Le journal intime est a priori, c’est
sa fonction première, la conservation de la mémoire. En réalité on
ne saurait à son propos que de parler de mémoire sélective. Aucun
diariste, aucun mémorialiste ne transcrit la totalité de ses souvenirs
de son expérience. La crudité d’un certain nombre d’écrits
récents paraît démentir ce propos. En réalité, cela ne doit pas être
si simple, si clair, puisque Catherine M. serait en analyse depuis
plusieurs années.
On
ne peut pas faire l’économie de l’inconscient qui est le véritable
lien de mémoire. Je dirai volontiers de vraie mémoire, celle qui
n’apparaît jamais complètement dans le discours parlé ou écrit.
Cela rejoint peut-être ce que Freud appelle « le fantasme
originaire ».
Quant
à l’oubli, c’est évidemment un mot qui sonne mal aux oreilles des
différents psy… Pour eux, tout oubli a un sens qu’il est possible
de décrypter. On se souvient de l’oubli par Freud de l’auteur des
fresques du jugement dernier de la cathédrale d’Orvieto, et
l’analyse qu’il en a fait pour aboutir à l’explication
oedipienne.
Ce
qui est certain, c’est qu’il n’y a pas, ou peu, d’oublis
innocents, et que l’oubli est une punition, un message destiné à
quelqu’un d’autre, ou déjà un mépris.
Dans
le cas de l’écrit intime, l’oubli peut-être délibéré. Julien
Green supprime certains passages de son texte (autocensure).
L’oubli
peut être assimilé à une résistance, résistance du Cà, du Moi …
ou plus encore du Sur Moi, plus peut être par rapport à l’image
d’un Moi idéal que le rappel de certains souvenirs, de certains
gestes ternirait trop.
Assez
curieusement, le Robert ne fait pas le rapprochement entre oubli et
refoulement, à la rubrique « oubli ». Par contre, à la
rubrique « refoulement » on peut lire « phénomène
inconscient de défense par lequel le Moi rejette une pulsion
(sexuelle-agressive) une idée opposée aux exigences du
Sur Moi.
Nous
illustrerons par quelques exemples de journaux intimes, ou remarques théoriques.
Mais il convient de s’attarder un peu sur cette forme littéraire bien
particulière qu’est le journal intime.
Le
journal intime est un écrit bien particulier où l’auteur,
écrivain célèbre, homme illustre, anonyme, rapporte au
quotidien ses sentiments, ses passions, ses regrets, ses joies et ses
tristesses. Il est devenu au fil des ans un genre littéraire bien spécifique
et certains écrivains, et non des moindres (Gide, Julien Green, Amiel)
firent leur célébrité, sinon davantage tout au moins autant,
de leur journal que de leurs autres œuvres.
Le
journal intime et sa publication apparaissent dans la littérature
occidentale au 17ème et 18ème siècle avec, en
Angleterre, Pepys et
Boswell. Michel Foucault note en fait dès l’antiquité les prémisses
de cet exercice littéraire. Il en prend comme exemple, tiré de la vie
des stoïciens « La vita d’Antoni d’Athanase ». Ce texte
présente la notation écrite des actions et des pensées comme un élément
indispensable de la vie ascétique. Cette pratique de l’écriture de
soi même « est en relation de complémentarité avec l’anachorèse
et n’admet donc pas ni oubli, ni défaillance alléguée
de la mémoire.
Foucault
donne un exemple de ces écrits intimes les hypomnemata, livres de vie,
de conduite où on consignait des citations, des fragments d’ouvrage,
des exemples et des actions dont on avait été le témoin. Ils se
situent dans le cadre d’une éthique très explicitement orientée par
le souci de soi vers des objectifs définis comme
se retirer en soi, s’atteindre soi-même, vivre avec soi-même,
se suffire à soi-même, profiter et jouir de soi-même.
C’est
donc une fonction fondamentale du journal intime que ce regard sur soi,
qui se doit d’être lucide et honnête, se gardant des oublis et des
pièges de la mémoire. Ce regard sur soi est le plus souvent
ambivalent. Il est rarement exclusivement positif, sauf peut-être, et
encore sous la plume d’Edmond de Goncourt ou de Léautaud qui
fonctionnent tous les deux sur un mode volontiers projectif, sous la
plume, par contre, de Stendhal, d’Amiel, les reproches sincères, ou
non, affluent. Ils remettent en cause leurs comportements, notamment et
surtout dans quelques situations amoureuses, où ils ont été confrontés
à un choix. C’est Amiel qui a sans doute, dans la perspective que
nous venons d’évoquer, souligné le mieux les différentes fonctions
du journal intime.
Vendredi
21 décembre 1860 (tome III p.15) 9 h. du matin. C’est ce journal qui
me permet de résister au monde hostile, à lui seul je peux conter ce
qui m’afflige ou me pèse. Ce confident m’affranchit de beaucoup
d’autres. Le danger c’est qu’il évapore en parole aussi bien mes
résolutions que mes peines, il tend à me dispenser de vivre, à
remplacer la vie. Il est ma consolation, mon cordial, mon libérateur,
mais peut-être aussi mon narcotique.
Plus
loin, il est peut-être mon principal idole, la chose à laquelle je
tiens le plus.
Ce
propos d’Amiel illustre parfaitement, nous semble-t-il, cette fonction
ambivalente du journal intime de l’écrivain quant à la passion de
soi-même.
Erreurs
ou lacunes mnésiques, oublis sont sans doute les pièges principaux de
tels écrits.
Nous
allons illustrer ces remarques par quelques exemples :
Le
journal de Stendhal,
Bien
sûr le journal d’Amiel,
Deux
extraits des journaux de 1942 de Pavese et Jünger.
Le
journal de Stendhal,
On se
souvient que dans ce texte, Stendhal, dans un style que l’on pourrait
qualifier de télégraphique, jette sur le papier ses désirs, ses
rencontres, ses espoirs amoureux ou littéraires, ses désillusions. En
même temps, il fait part de ses lectures, des commentaires qu’elles
entraînent, de ses impressions quant aux paysages, aux œuvres d’art
qu’il observe. Il note également ses critiques de théâtre.
Celles-ci sont même particulièrement nombreuses. On sait le penchant
très fort de Stendhal pour l’art lyrique. Une partie de ces notations
de journal constitue évidemment le support d’autres écrits,
notamment les récits des voyages en Italie. Le journal de Stendhal est
avant tout l’enregistrement minutieux de ses préoccupations
amoureuses. On voit apparaître la naissance d’un désir, la stratégie
mise en œuvre pour l’accomplir, l’exultation quand il est
satisfait, les reproches ou les lamentations mais jamais totalement dénués
d’humour quand il n’aboutit pas. Stendhal n’hésite pas à se
fustiger de ses hésitations, de ses timidités. En état permanent de
vigilance séductrice, il se reproche amèrement, comme le fera plus
tard Leautaud, grand admirateur de Stendhal, chaque occasion qu’il
n’a pas saisie.
Le
27 Avril 1810 : « j’y ai trouvé la comtesse Palfy qui
m’a constamment regardé avec intérêt « vous êtes venue
bien tard ».
Elle
a toujours cherché à me prendre la main. J’ai légèrement serré la
sienne, mais j’ai eu tort de ne pas l’embrasser dans le petit
cabinet ; nous n’y étions que deux hommes et j’y étais même
autorisé à le faire par la pénitence qu’elle subissait. Je prends
mon grand courage et je décide que je donnerai un baiser sur sa joue ou
sur sa main à la première occasion. On finit par mépriser un nigaud
qui ne profite de rien.
Stendhal on s’en souvient fait même état
de ses défaillances amoureuses et, reprenant une idée déjà exprimée
par Montaigne, repère parfaitement que l’échec est d’autant plus
à redouter que le désir est plus vif et que le projet amoureux a été
plus attendu et plus investi… Il fait là d’ailleurs véritablement
œuvre de psychopathologiste avant la lettre et témoigne d’une
intuition très fine des mécanismes inconscients. Il use comme Pepys de
procédés un peu infantiles pour tenter de dissimuler (à lui-même
sans doute) ses passions du moment, entremêlant son texte français de
fragments en italien ou en anglais, généralement consacrés à ses
espoirs ou à ses déboires amoureux.
Le 7 Juin 1810 (16), après avoir évoqué
une soirée libertine avec quelques jeunes femmes, mais ne s’étant
pas terminée exactement comme il l’espérait, il écrit : « malgré
tout j’accrochai à good and sufficientemente raparito kiss ».
Stendhal est en perpétuelle quête amoureuse et il mène celle-ci comme
un combat, la conquête d’une femme désirée étant comparée à la
chute d’un bastion. On est à l’époque napoléonienne et on sait
l’admiration de Stendhal pour l’Empereur. Du même coup, en bon
stratège, à défaut de victoire complète, il enregistre chaque avancée
dans son dessein si minime soit-elle. Il décrit une de ses conquêtes
amoureuses sous la rubrique : « Histoire de la bataille du
31 mai 1811 ».
Stendhal, tenant son journal, a bien le
sentiment tout comme Freud quand il se libre à l’analyse de ses
propres rêves, de faire œuvre universelle quant à la connaissance de
l’âme humaine et qu’il est possible d’extrapoler de la
connaissance de soi-même, la connaissance de tous les hommes.
9-11 juillet 1810. Nosographie des
passions et des états de l’âme. Lire les premières pages de la
nosographie de Pinel et faire celle dont j’ai besoin (9 juillet 1810)
(18). Faire un journal nosographique où j’inscrirai chaque soir, à
l’article Vanité, les traits vaniteux observés, à l’article
Avarice, les traits d’avarice, enfin sous le titre de chaque passion,
état de l’âme, etc…, ce que j’aurais observé. Ces signes
frapperont mon imagination et doubleront les forces de mon esprit. Je
suis sujet à ne plus pouvoir suivre une idée, faute de me rappeler
sans peine un instant après l’avoir conçue (11 juillet 181
Même si Stendhal introduit
indiscutablement une nouvelle manière de tenir un journal, ses écrits
intimes, malgré leur ton très libre, gardent l’empreinte des livres
de raison des siècles précédents.
Le parfait agnostique garde quelque chose de la confession, de la
contrition et des résolutions qui doivent s’ensuivre, même si ces résolutions
portent sur des terrains inhabituels. On trouve fréquemment d’autres
réminiscences de livre de raison quand Stendhal fait ses comptes et ses
prévisions financières, avec d’ailleurs un réalisme assez relatif
dans ces domaines.
On ne saurait, pour le journal de Stendhal,
parler de lacunes de la mémoire, d’oublis. Par contre bien qu’écrits
dans l’immédiat ou presque, il y a un aménagement des souvenirs, même
s’il est loin de toujours se donner le beau rôle, notamment dans ses
entreprises amoureuses. Il est sans doute plus authentique dans sa démarche
autobiographique, dans la vie d’Henri Brulard, encore qu’il aménage
ses souvenirs notamment pour tout ce qui concerne son père.
Le Journal d’Amiel
Un
peu plus loin dans le 19ème siècle, le journal d’Amiel va
constituer l’indispensable référence dans l’approche critique des
écrits intimes, l’élément de comparaison avec tous les travaux du même
type.
Amiel
a vécu 60 ans, de 1821 à 1881. Il avait perdu sa mère de tuberculose
alors qu’il avait 11 ans. Son père se suicidera en se jetant dans le
Rhône. Ces deuils parentaux précoces l’ont certainement profondément
marqué et rendent compte largement de sa personnalité, de ses
comportements et aussi, on peu l’écrire sans doute sans excès de sa
pathologie. Professeur à Genève, il publiera quelques essais et poèmes
qui ne paraissent pas avoir eu un grand retentissement. Les premières
publications de fragments de son journal intime n’auront lieu qu’après
sa mort, par le biais de ses exécuteurs testamentaires. Bien que
l’intérêt soulevé parce journal ne se démente pas, qu’il fasse
l’objet de nombreuses études critiques, de thèses médicales, il
faudra attendre 1976, soit près d’un siècle après la mort de
l’auteur, pour que l’Age d’homme en entreprenne la publication intégrale.
Ce
journal, qui comporte plus de 17 000 pages, va désormais constituer le
modèle incontesté en matière de journal intime encore que, y compris
parmi ses admirateurs les plus fervents, son abondance, ses redites,
pour ne pas dire ses rabachâges, ses ratiocinations soulèvent d’inévitables
réserves. Ceci étant, tous s’accordent pour souligner l’importance
du phénomène.
Si le Journal d’Amiel revêt une telle
importance à mes yeux, ce n’est pas uniquement pour ses qualités
littéraires mais aussi parce qu’il nous fait entendre pour la première
fois dans l’histoire de l’humanité l’écho mille fois amplifié
des vibrations les plus ténues d’une âme. Tempête sous un crâne ou
tempête dans une tasse de thé ? Toujours est-il qu’Amiel
inaugure dans le champ littéraire psychologique un genre aussi révolutionnaire
que Freud avec son auto-analyse. Il y a un avant Amiel et un après
Amiel, comme il y a un avant Freud et un après Freud ». (Roland
Jaccard).
Leautaud
mis à part, il n’y a sans doute pas de phénomènes comparables dans
sa littérature universelle au journal d’Amiel. On a pu dire de
l’auteur qu’il écrivait sa vie plutôt que de la vivre, et que
cette écriture permanente constituait un substitut de l’existence
qu’il n’avait pas, notamment sur le plan affectif et sexuel. On
pourrait dire en termes plus contemporains que le journal représente
pour Amiel un véritable objet transitionnel au sens que l’on donne à
ce terme depuis Winnicot.
« Je
me hasarde à avancer qu’il existe un état intermédiaire entre
l’inaptitude du petit enfant à reconnaître et à accepter la réalité
de son aptitude croissante à la faire. Ce que j’étudie ici c’est
donc l’essence de l’illusion, celle qui est permise au petit enfant
et qui est propre à l’art et à la religion dans la vie adulte ».
Cet
état intermédiaire est comblé chez le jeune enfant par les objets
transitionnels dont il dispose : ours en peluche, morceau de drap,
fragment de vêtement, etc… Chez l’adulte, l’objet culturel peut
remplir la même fonction. Protection contre la régression narcissique
complète ; il constitue également un rempart contre les dangers
d’un monde environnant perçu comme menaçant, voire comme dangereux.
On peut sans peine imaginer la fonction transitionnelle du journal chez
Amiel. Soumis pendant la pré-adolescence à des blessures affectives
graves, il sera toute sa vie un blessé, voire un écorché, sensible à
toutes les blessures, tous les rejets, si minimes soient-ils parfois. A
ce niveau le journal a certainement valeur thérapeutique.
Pour
l’immédiat, nous nous en tiendrons à une brève analyse formelle, la
force de ce journal conditionnant franchement celle de la plupart des
journaux intimes faisant suite à celui d’Amiel, même si leurs
auteurs apparemment tentent de s’en distancer.
Chez
Amiel, on retrouve un peu à tous les moments de son évolution la même
composition du journal, qui apparaît du même coup comme un texte très
écrit … lectures, rencontres, préoccupations financières,
occupations quotidiennes, descriptions du temps, du paysage sont présentes
à presque toutes les pages et, à ce titre, Amiel peut être considéré
comme excellent chroniqueur aussi bien de la vie genevoise que de la vie
familiale ou amicale. Quantitativement en réalité, ces commentaires
occupent une place fragmentaire dans le texte, l’essentiel étant fait
de considérations de l’auteur sur lui-même, son fonctionnement
physique et psychique, ses doutes, ses reproches. Il s’agit dans la
tradition protestante d’un examen de conscience répétitif sans
complaisance, avec la constatation réitérée… de sa médiocrité, de
son indécision, de son absence de progrès, etc…
Amiel s’adresse à lui-même comme
d’habitude le lundi 13 novembre 1865 (tome IV) p.42
« La
vie à différer se passe dit le poète. La fatalité de ta destinée
est d’avoir épuisé tes jours en prérogatifs et en velléités, en
projets et en préludes, sans aboutir, sans conclure, sans réaliser ou
en un mot sans produire. Que restera t-il donc de tant d’efforts
dispersés et de tant d’études commencées ? Rien. Et pourquoi ?
faute de suite dans la volonté. Et d’où vient ce défaut de
constance ? d’un manque d’intérêt suffisant. Tu as été très
vite découragé, sans espérance, sans ambition et à qui la faute ?
A ceux-mêmes qui t’en font reproche. Tu as donné infiniment moins
que tu ne semblais promettre… ».
Plus loin « Et l’indolence aidant, tu as pris l’habitude de
ne rien finir, de ne rien vouloir et même de ne tirer profit de rien ».
On retrouverait sans peine tout au long des 17 000 pages du journal des
notations de la même tonalité. Janet parlait, pour qualifier le vécu
du psychasthène, de la baisse de la tension psychologique, du sentiment
d’incomplétude. Au-delà des auto-accusations puritaines, liées sans
doute à sa formation calviniste, il y a chez Amiel la conscience
douloureuse de son état ressenti comme un handicap permanent, voire
comme une infirmité. On peut, en termes psychopathologiques parler de dépression
névrotique chronique, que les classifications nord-américaines
qualifieraient de dysthymie. Amiel, et on le retrouve dans son journal,
a parfois des moments de plaisir, la découverte d’un beau paysage, la
musique, la rencontre avec des parents ou amis, mais ces moments de paix
relative ne durent pas et il retombe constamment dans les mêmes gémissements.
Les
considérations sur la vie affective, le célibat, les projets éventuels
de mariage constituent en fait la trame permanente de l’ouvrage. On
sait qu’Amiel n’a jamais cessé de s’interroger sur ces questions
doutant en permanence de lui-même, envisageant le mariage comme une nécessité
vitale pour lui, puis presque dans le même temps, en évaluant les
inconvénients. Il devait même en 1867 aller jusqu’aux fiançailles
avec Perline, puis accablé par sa décision, revenir en arrière,
rompre les fiançailles, rationalisant sa décision par les reproches
dont il accable la malheureuse. Aussitôt prise d’ailleurs, cette décision
de rupture est remise en question, regrettée.
Il
est tout à fait amusant dans cette perspective de reprendre l’itinéraire
amoureux d’Amiel largement évoqué dans le journal de 1867.
Deux
femmes mûres lui font une cour empressée ; il les repousse, bien
qu’il se sente attiré. Il fait finalement sa demande en mariage à
une jeune fille douce, bonne, modeste, tout en déplorant déjà que ce
ne soit pas une intellectuelle.
Il
note, le 21 février 1867 : « mélancolie. Rien ne me réussit
ces temps et ma santé s’entame. Insuccès à l’Académie, peu de
satisfaction avec ma fiancée, cerveau dolent et maintenant un fort
rhume : présent fâcheux, perspectives prochaines déplaisantes… ».
Peu de satisfaction avec ma fiancée. Amiel
peut-il quelques fois trouver des satisfactions ? On voit émerger
toute une série de revendications à ce sujet, y compris matérielles.
Amiel se voudrait une belle âme mais il est aussi un bon bourgeois de
Genève, très préoccupé de son argent.
Les
hésitations quant au mariage se poursuivent. Le 22 février 1867 :
« je sens que nous dérivons du coté des unions
vulgaires où l’on s’unit médiocrement ». Ces doutes, du
coté du cœur, entraînent une exacerbation des inquiétudes de
l’auteur avec des vaticinations interminables autour du mariage. Il
s’agit d’ailleurs bien davantage du mariage en soi, de sa
signification symbolique, que du mariage avec quelqu’un.
Il
va passer le 26 mars à la rancune vis à vis de sa fiancée et de sa
famille qui s’étaient inquiétées de ses atermoiements. Il
s’indigne. On ne l’a pas compris. On ose s’étonner qu’il ait
souhaité plus d’amour et de culture de la part de sa fiancée.
Son
propos, qui n’est pas très loin de celui de Jean-Jacques son
compatriote, a pris une teinte franchement paranoïaque.
« Voilà
toutes mes meilleures intentions retournées contre moi. Cela me révolte
à la fin, sinon contre les gens qui sont comme ensorcelés par une
incantation diabolique, au moins contre la destinée qui abuse de la
permission d’être injuste. Comment pouvais-je être plus délicat,
plus sincère, plus loyal que ne l’ai été ici »
Le
propos a pris peu à peu une teinte délirante persécutoire avec une
tonalité interprétative certaine.
« Qui est la victime ici ? Qui
méconnaît-on ? Envers qui manque-t-on d’égards ? En vérité
le guignon odieux finira par me mettre en colère et l’indignation me
montera à la gorge. Qui se fait mouton, le loup le mange. Trop de mansuétude
et trop de sottises, le respect a des bornes et le droit de la défense
personnelle peut me remettre à la main l’épée de la vérité vraie.
Qui donc à ma place n’eut pas été interloqué, » etc…
Le
29 mars 1867 : « Tout est fini entre K et moi… on ne
m’a pas fait mon droit … j’ai surfait Perline… elle ne vaut pas
ce que je pensais d’elle dans ma candeur par trop généreuse ».
Il
s’agit dans ce long passage du journal d’Amiel d’un véritable
plaidoyer sous-tendu de nombreuses rationalisations, de l’écriture
d’un épisode que l’on peut sans excès considérer comme
pathologique, dans la mesure où son auteur attribue à l’autre, sur
un mode projectif, la totale responsabilité des difficultés, se révélant
incapable d’une remise en cause de son attitude personnelle, incapable
également de percevoir son handicap affectif, son inaptitude névrotique
à la création d’une relation amoureuse.
On
sait en fait l’échec complet de la vie amoureuse et sexuelle
d’Amiel. La légende ne lui attribue qu’un rapport sexuel dans sa
vie. Qu’en est-il exactement ? Cette comptabilité n’a en fait
pas grand intérêt. Plus intéressant est de noter que les rares
manifestations d’une sexualité inhibée (pollutions nocturnes) entraînent
un malaise existentiel diffus et un état proche de la dépersonnalisation.
Amiel, à travers son journal, apparaît, il est presque le contemporain
de Janet, que nous avons déjà évoqué, comme une personnalité
psychasthénique typique. Il est douteur, hésitant, scrupuleux et toute
manifestation affective et a fortiori sexuelle, entraine chez lui une
baisse de la tension psychologique, un malaise physique et psychique
avec altération temporaire du sens de la réalité. On considère la
personnalité d’Amiel comme une personnalité obsessionnelle typique,
le journal étant à la fois l’expression de cette névrose et une
tentative permanente pour la conjurer, sinon les traiter dans ce que
l’on peut considérer comme l’équivalent d’une thérapie
cognitivo-comportementale. Comme nous l’avons déjà noté, Amiel
considère le journal tenu quotidiennement comme son seul consolateur.
On peut bien sûr estimer à juste titre que la valeur psychothérapique
de ce journal a été faible quand on voit la similitude des contenus
d’un bout à l’autre de l’histoire d’Amiel. On peut penser à
contrario que ce journal a eu tout de même valeur carthartique,
protectrice, vis à vis d’une dépression peu profonde. On se rappelle
que le père d’Amiel s’était suicidé en se jetant dans le Rhône.
Il y avait peut-être chez Henri-Frédéric une prédisposition génétique
à la mélancolie à laquelle le journal a servi d’antidote.
In
fine, le journal a certainement constitué la véritable passion d’Amiel,
la source de toutes ses joies véritables, les seules possibles sans
doute dans son enfermement narcissique.
On ne saurait à propos du journal d’Amiel évoquer troubles de mémoire
ou oublis. Il y a même accumulation méticuleuse de faits, d’événements,
même très mineurs. Par contre, comme pour Stendhal on ne peut qu’être
frappé du peu de lucidité de l’auteur à son égard, d’un
fonctionnement qui, à certains moments, notamment dans sa vie
amoureuse, rejoint celui de Jean-Jacques son compatriote, avec une note
projective indiscutable, à certains moments.
Nous
terminerons ces exemples sur mémoire et oubli dans les écrits intimes,
par deux extraits de journaux de 1942 de Jünger et de Pavese.
Jünger,
héros de la guerre de 1914, plusieurs fois grièvement blessé et décoré,
est en 1942 en dehors de la guerre, bien qu’il soit affecté à l’Etat
Major allemand de Paris. Il est sans illusion sur l’avenir de son pays
et du régime qui le dirige, s’opposant même à ce régime. On sent
bien que ce problème éthique et politique est pour lui dominant et
qu’il s’efforce, par l’utilisation de son intelligence et de ses
connaissances, de se distancer des préoccupations quotidiennes d’où
des oublis qui sont bien davantage des omissions volontaires ou des résistances.
Il note, par exemple, que certains rêves ne peuvent se noter. Il écrit
à ce propos toute une série de phrases révélatrices : « ces
rêves qui ne peuvent se noter nous ramènent en de çà du pacte ancien
et puisent au terrible fond primitif, matière première de l’humanité.
Il dit encore qu’il faut taire ce qu’on a vu là-bas. Il s’agit
d’un passage tout à fait révélateur de l’attitude profonde de
l’auteur, mélange de confidences limitées et de réserve extrême.
La place des rêves dans ce texte est importante mais Jünger n’entre
jamais dans leur interprétation, c’est ainsi qu’il écrit le 1er
juillet 1942 : « rêves
nocturnes, révélation au plus profond de moi-même de la signification
secrète des chambres. Elles communiqueraient toutes avec la pièce où
je dormais, la chambre de la mère, celle de la femme, de la sœur, du
frère, du père et de l’amant, et toutes ces chambres muettement
vivantes, très proches et très isolées avaient au même degré un
caractère solennel, un mystère effrayant ».
Chez
Jünger, la mémoire est intacte. Il n’y a pas d’oubli mais une
volonté délibérée de sélectionner, dans son journal, les propos
qu’il a envie de tenir.
Cesare Pavese est, quant à lui, en 1942 âgé de 34 ans. Il se
suicidera en 1950 dans une chambre d’hôtel de Turin. Son opposition
au fascisme lui a valu d’être exilé en 1935. Son drame personnel est
dominé par une impuissance sexuelle génératrice d’une dépression
grave qui aboutira au suicide. Le journal qui n’était sans doute pas
destiné à la publication paraîtra à titre posthume. Il s’agit
avant tout de carnets de travail où s’entremêlent chroniques de
lecture, réflexions, pensées. Pavese garde constamment une distance
pudique vis à vis de lui-même. Il ne cède pas non plus au possible
aspect « chronique » du journal intime et il indique même
« l’ennui indicible que provoquent en lui, dans les journaux
intimes, les « pages de voyage ». Il s’explique même un
peu plus à ce sujet, en écrivant que ces impressions ont plu à
l’auteur parce qu’elles ont d’étonnant, mais ajoute t-il, l’étonnement
vrai est fait de mémoire, non de nouveauté.
Cette
quête mnésique est une dominante du journal. Il s’interroge sur les
relations entre le présent, plus précisément les relations entre les
perceptions présentes et passées. Il écrit même, avec des actions
authentiquement freudiens, qu’il faut toujours, pour qu’une expérience
nouvelle puisse s’intégrer dans le présent d’un individu,
qu’elle se déroule dans l’atmosphère d’une acquisition
infantile.
Il
dit, par exemple : « voir les choses pour la première fois
n’existe pas ». Il note aussi l’inéluctabilité du destin
individuel et le fait que presque tous nous retrouvons dans notre
enfance les signes de l’horreur adulte.
Journal
intime … reflet de soi-même … plus ou moins fidèle d’ailleurs,
étayage narcissique, baromètre de l’état mental du moment, le
journal peut être aussi le témoin, le notaire, enregistrant fidèlement ;
on pourrait épiloguer sur cette notion de fidélité. Fidélité du
souvenir et de l’écrit quand il s’agit du corps, et particulièrement
du corps souffrant, beaucoup plus discutable quand il s’agit de
l’esprit, des sentiments, des états affectifs, les atteintes du
corps, les ravages d’une affection parfois inexorable… c’est
particulièrement exact avec le journal de Mathieu Galey. On pourrait,
de la même manière, épiloguer sur les écrits autobiographiques de
Claude Roy au moment de la découverte et de la mise en place du
traitement de son cancer du poumon.
On
en vient là à la dernière partie de notre réflexion. Analogies et
différences entre écrit intime et psychothérapie – oubli – ou
plutôt résistance, mémoire infidèle, ou plutôt sélective, on en
revient toujours, d’une manière ou d’une autre, à la question de
Pilate « qu’est ce que la vérité ? ».
En
conclusion de cette réflexion sur la passion de soi, dessinée, montrée
à travers le Journal Intime, se pose la question de savoir quelles sont
les relations profondes entre journal intime et psychothérapie. Il y a
certes, nous l’avons souligné, des analogies et des différences. Au
total, les analogies entre journal intime et psychothérapie sont
indiscutables. Les deux démarches ont certainement valeur thérapeutique
permettant une meilleure connaissance de soi-même. L’une d’entre
elle l’emporte t-elle sur l’autre ? seuls les intéressés
pourraient répondre à cette question, plusieurs et non des moindres,
ayant eu recours aux deux formules (Leiris, Anaïs Nin, Pontalis…)
d’autres récusant complètement l’une des deux formules
(Gombrowicz, la psychanalyse, Kafka…) qui en contestait la portée,
tout en se livrant dans son journal et sa correspondance, à de
nombreuses confidences sur lui-même.
Le
journal intime constitue certainement, parmi d’autres, un moyen privilégié
d’aborder le registre complexe des passions
Le
véritable problème est celui du transfert, qui est la clef de voûte
de toute démarche psychothérapeutique et qui suppose la présence
d’un interlocuteur de référence. Dans le journal intime, cet
interlocuteur est à la fois « absent présent »,
l’interlocuteur invisible et silencieux auquel on s’adresse. Le
diariste, implicitement, s’adresse à ses amis, à ses détracteurs,
à ses complices, mais comme dans la démarche analytique il n’a pas
de réponse. Mais, en même temps, il sait très bien qu’il n’y a
personne et qu’il est renvoyé à lui-même. C’est peut-être aussi
l’issue d’une démarche psychothérapique qui fait au bout du compte
qu’il n’y avait pas autant de différence qu’on pouvait
l’imaginer et que la démarche auto-thérapeutique avait ses vertus.
En
réalité, il n’y a pas d’auto-analyse. Mannoni, Anzieu, ont bien
montré la relation transférentielle qui s’était instaurée entre
Freud et Fliess et qui était le support de son « auto »
analyse. Plusieurs pages de l’interprétation des rêves en témoignent.
De même, l’absence de critique de Freud vis à vis des élaborations
théoriques de Fliess, aux confins parfois des idées délirantes.
Le
diariste a toujours, même s’il n’est pas nommé, un interlocuteur.
Il s’adresse à un personnage invisible qu’il a mis alternativement
en position de témoin, de juge, de défenseur. Martin du Gard faisant
étant dans son journal de sa déception, voire de sa colère, devant
les relations entre sa fille et vieil ami Coppet s’adresse en fait à
ce dernier, et exprime dans son journal la rancœur qu’il n’ose pas
verbaliser en direct.
Après
avoir souligné à travers 4 exemples les fonctions bien particulières
du journal intime : exaltation et/ou mortification de soi-même,
oscillation métaphoro-métonymique du narcissisme (Rosolato) il
convient de souligner un aspect bien particulier du journal intime :
à savoir, sa fonction psychothérapique pour son auteur avec les
analogies et les différences entre les deux registres.
Analogies,
l’inscription au jour le jour des sentiments, des impressions, des rêves,
peut être comparée à l’association libre, proposée par Freud comme
la démarche fondamentale en analyse. Analogies encore, les résistances
qui se retrouvent dans les deux registres, omissions dans le journal
intime, droit à la censure revendiqué par exemple par Julien Green,
Jules Renard.
Analogies
encore … la référence à la mémoire ; Viderman écrit que dans
les quarante années de son œuvre Freud n’a pas varié pour
l’essentiel de sa pensée qu’elle témoigne d’une unité et
d’une cohérence qui sont celles de la permanence du même postulat
qu’on trouvait à l’origine de son intuition première et qui fonde
toute sa recherche. La névrose est une maladie de la mémoire :
conséquence d’événements perdus ou si radicalement altérés
qu’ils en sont devenus méconnaissables. Si la névrose est un temps
perdu, la technique analytique a pour tâche de récupérer
l’histoire. L’écrit intime a pour nous la même signification
encore comme le dit Georges May « l’impuissance à exprimer la vérité
doit être tôt ou tard reconnue par tout autobiographe ».
Autre
analogie, l’intérêt porté en psychanalyse sur les stades précoces
du développement. L’intérêt porté à la problématique
identitaire, à la dimension narcissisme.
Le
journal intime privilégie largement cette dimension au détriment de la
relation objectale. Le solipsisme est la règle de base de l’écrit
intime, apologie de soi-même, plaidoyer pour soi-même (Rousseau ,
Berlioz) au dépens de la dimension objectale qui est souvent absente
(cf. Martin du Gard – sa relation avec Coppet et sa fille).
La
véritable différence, et elle est considérable, est dans la problématique
du transfert ; certes l’auteur du journal intime s’adresse en
fait à un interlocuteur invisible et silencieux, comme le
psychanalyste, objet d’amour, de haine, d’ambivalence mais il sait
parfaitement qu’il est seul face à lui-même, et comptable sans témoin
de ses troubles sélectifs de la mémoire, des oublis.
Bibliographie complète
Guy
besançon : l’Ecriture de Soi – L’Harmattan –
2002.
|